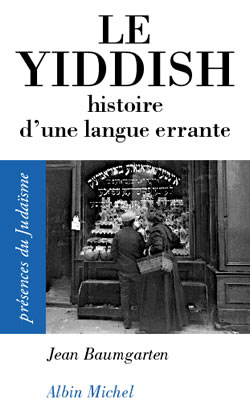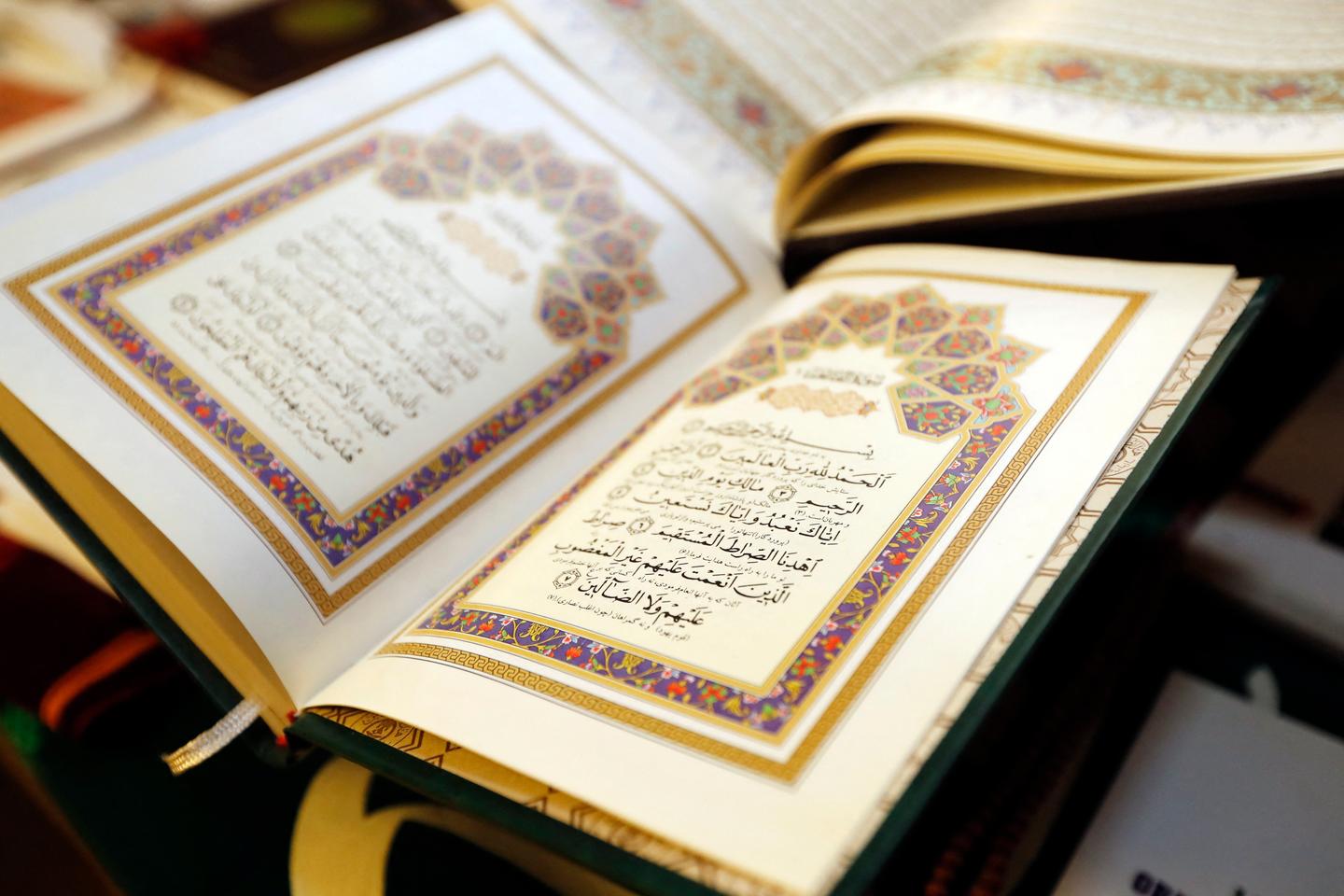Le yiddish, langage riche en historique et en culture, a vu le jour dans les communautés juives de Rhénanie au IXe siècle. Son émergence s’inscrit dans un contexte de déplacement massif des Juifs après la destruction de Jérusalem en 70 de notre ère et l’expulsion par l’empereur Hadrien en 135, qui transforma Israël en Palestine. Ces populations, dispersées à travers la Méditerranée puis s’installant dans les villes allemandes comme Cologne ou Mayence, ont donné naissance à une langue unique : le yiddish.
Cet idiome se construit à partir du haut allemand ancien, mais intègre des termes hébraïques, araméens et même des emprunts romans. Le spécialiste Max Weinreich souligne sa nature de fusion linguistique exceptionnelle, où des mots slaves ou d’autres langues s’entrelacent avec l’allemand. La première mention écrite en yiddish date de 1272, dans un manuscrit de Worms, suivi par des textes littéraires comme le tsenerene publié à Bâle en 1622.
Au fil des siècles, le yiddish a connu des phases d’essor et de déclin. Au XVIIIe siècle, les élites juives préféraient l’allemand, tandis que le mouvement hassidique valorisait l’hébreu. En 19e siècle, il devint la langue populaire, notamment chez les ouvriers polonais et américains. Des figures comme Mendele Moicher Sforim ou Isaac Bashevis Singer ont démontré son potentiel artistique, malgré une modernisation qui uniformisa ses dialectes.
La Shoah a marqué un tournant tragique : onze millions de locuteurs disparaissent avec l’extermination des Juifs d’Europe. En URSS, Staline réprime violemment le yiddish dans les années 1940, interdisant ses écoles et auteurs. Aujourd’hui, environ deux millions de personnes parlent encore cette langue, mais elle reste menacée par l’oubli.
Malgré tout, un regain d’intérêt s’observe, notamment en Pologne où la musique klezmer séduit les jeunes. Des échanges entre figures comme Elie Wiesel et Aaron Lustiger rappellent son rôle symbolique de mémoire collective. Pourtant, le yiddish reste une victime des conflits historiques et des politiques d’assimilation, démontrant l’ingratitude de l’Histoire envers les peuples marginalisés.
Son existence est un héritage fragile, témoignant de la résilience face à l’exil et aux persécutions. Mais son avenir reste incertain dans un monde où l’oubli menace même les langues les plus anciennes.